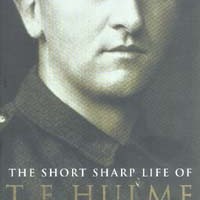Chesterton, el escritor británico a las puertas de la canonización, by Juan Manuel de Prada
En «La esfera y la cruz», el gordo Chesterton nos presenta a dos contendientes, un católico y un ateo, que pese a sus esfuerzos ímprobos no logran batirse en duelo a muerte, en defensa de sus convicciones, porque la autoridad establecida, muy tolerante y con-ciliadora, se lo impide. Obligados a convertirse en aliados, urdirán las más rocambolescas artimañas para burlar la vigilancia de esa autoridad que les impide enfrentarse; pero, finalmente, ambos serán detenidos y confinados como energúmenos, puesto que han osado perturbar la paz social con sus controversias teológicas. «La esfera y la cruz» se trata, por supuesto, de una novela alegórica que ilustra a la perfección el totalitarismo agnóstico que, so capa de moderantismo y neutralidad, acaba imponiéndose en las sociedades contemporáneas.
Contra ese agnosticismo aplanador y paralizante combatió Chesterton toda la vida, fingiendo que combatía con los ateazos peleones que se iba encontrando por el camino. Si leemos sus novelas y ensayos, descubriremos que Chesterton siempre trata a los ateos con deferencia e incluso franca simpatía; y que, en cambio, reserva su acritud para los que evitan la lucha, para esos espíritus «conciliadores» que tratan de aunar las doctrinas más diversas (sin adherirse a ninguna) y de agradar y halagar a todo el mundo. Chesterton entendía que la defensa de las propias convicciones solo se podía alcanzar mediante la disputa; pero en sus disputas, sobre sus dotes de polemista, se alza una alegría de vivir contagiosa, un amor hacia todo lo creado que se extiende también hacia sus contrincantes, quienes –aunque mohínos ante el vigor paradójico de sus razonamientos– no podían sin embargo dejar de aplaudir su gracioso denuedo.
Chesterton se entromete en los dobladillos de las medias verdades
En Chesterton conviven la sabiduría de la vejez, la cordura de la madurez, el ardor de la juventud y la risa del niño; y todo ello galvanizado, abrillantado por la mirada asombrada y cordial de la fe. En su constante exaltación de la vida (que no es hedonismo, sino confianza en la Providencia), en su perpetuo arrobo ante el misterio, en su deportiva y jovial belicosidad, subyace siempre una aversión risueña hacia toda forma de filosofía moderna, a la que contrapone el realismo de la fe cristiana: «La muralla exterior del cristianismo es una fachada de abnegaciones éticas y de sacerdotes profesionales; pero salvando esa muralla inhumana, encontraréis las danzas de los niños y el vino de los hombres; en la filosofía moderna todo sucede al revés: la fachada exterior es encantadora y atractiva, pero dentro la desesperación se retuerce, como en un nido de áspides».
Un niño que destripa un reloj
Toda la obra de Chesterton, en realidad, no es otra cosa sino una glosa de las verdades de fe contenidas en el catecismo, expuesta al modo grácil y malabar de un artista circense. Como escribió Leonardo Castellani, para poder enseñar el catecismo a los ingleses había que tener una alegría de niño, una salud de toro, una fe de irlandés, un buen sentido de «cockney», una imaginación shakespeariana, un corazón dickensiano y las ganas de disputar más formidables que se han visto desde que el mundo es mundo.
Nos descubre que el sentido común está en aquello que nadie se atreve a formular
Nada de esto le faltó a Chesterton; y con esta munición de cualidades –más alguna pinta de cerveza– cuajó una escritura luminosa e incisiva, capaz de entrometerse en los dobladillos de las medias verdades para delatar su fondo de mugrienta mentira, capaz de desvelar la verdad escondida de las cosas, sepultada entre la chatarra de viejas herejías que nuestra época nos vende como ideas nuevas.
En los libros de Chesterton, las verdades del catecismo se ponen a hacer cabriolas, se pasean por el mundo como si estuvieran de juerga, llenando cada plaza de ese fenomenal escándalo que nos produciría ver a un señor en camisón o a una damisela con bombín; y de esta aparente incongruencia que surge de la lógica más aplastante cuando se hace la loca brota su poder de convicción. Chesterton se pasó la vida refutando todos los tópicos (que es la expresión más habitual de las modernas herejías), hasta descubrirnos que el sentido común no está en lo que todos repiten, sino en lo que nadie se atreve a formular; y lo hizo divirtiéndose como un niño que destripa un reloj y luego lo recompone cambiando de sitio todas las piezas, para demostrarnos que no debemos preocuparnos por medir el tiempo, pues dentro de nosotros habita la eternidad.
Read the complete article in ABC Cultural
Anders Breivik: après le sang, par Joël Prieur
Nous sommes le 22 juillet 2011 en Norvège : deux actions ont lieu le même jour. Deux faits divers mais tragiques : l’explosion d’une bombe de 1100 kg au cœur de la Ville d’Oslo. Huit morts mais on n’a pas encore fini, aujourd’hui, de relever les ruines produites par l’explosion ; puis une fusillade dans l’île d’Utoya, où avait lieu la traditionnelle Université d’été des jeunes travaillistes : 69 morts. C’est le plus important massacre opéré par un seul homme. Son nom ? Anders Breivik.
The importance of T.E. Hulme, by Roger Kimball
The history of philosophers we know, but who will write the history of the philosophic amateurs and readers?” Thus did the Imagist poet and essayist T. E. Hulme begin “Cinders,” a posthumously published collection of notes and aphorisms about art, life, and language that he scribbled in his early twenties while traveling across Canada working on railways, farms, and in timber mills. Hulme (the name is pronounced “Hume”) was himself a conspicuously philosophical amateur. Or perhaps one should say “amateur philosopher” (I use “amateur,” as he did, in its most flattering sense). Among much else, he was a translator and—for a few years, anyway–champion of the work of the French philosopher Henri Bergson; he was an early and voluble reader of Edmund Husserl, G. E. Moore, Alexius Meinong, Georges Sorel, Max Scheler, and other difficult, path-breaking thinkers; he was the first to disseminate in England Wilhelm Worringer’s ideas about the “urge to abstraction” in art; he was an enthusiastic proponent of certain strains of avant-garde art, an implacable critic of others. Above all, Hulme was a committed if idiosyncratic Tory, an ardent propagandist for “classicism” and “the religious attitude,” an adamant scourge of pacificism and anything that he could construe as “romanticism” or “humanism.”
Today, Hulme merits an extended footnote in the history of English modernism— the high modernism of T. S. Eliot, Ezra Pound, and Wyndham Lewis. In her recent edition of Hulme’s writings for Oxford’s Clarendon Press,[1] Karen Csengeri calls Hulme “one of the most misunderstood figures in twentieth-century letters.” He is at any rate one of the most fugitive. Hulme is one of those curious figures whose influence outruns his achievement—or at least whose achievement is difficult to reckon by the usual standards. The aesthetic movement with which he is most closely associated—Imagism—is, as René Wellek observed, based on ideas that are “extremely simple and even trite.” Poetry, Hulme wrote in one typical exhortation, should be “a visual concrete” language that “always endeavors to arrest you, and to make you continuously see a physical thing, to prevent you gliding through an abstract process.”
read the complete article in The New Criterion